Archives pour la catégorie “ouverture”
à quoi (me) sert ce blog?
ou encore : à propos de ce blog
Laissons de côté les exclamations – admiratives ou dépitées – dont l’usage de la Toile s’accompagne souvent. La possibilité que tout un chacun puisse, au prix d’un léger effort de concentration, créer son blog gratuitement et librement, permet à toute personne qui a envie et besoin d’écrire de poser ses brouillons dans la Toile, en s’imaginant que des passants vont pouvoir les lire. Ce n’est ni révolutionnaire, ni vain.
Même si l’écrivant ne cherche pas à toutes forces à se faire référencer par les moteurs de recherche, même s’il souhaite que son blog demeure confidentiel, il sait – avec la nécessaire et délicieuse mauvaise foi qui accompagne souvent ce genre de savoir – qu’il peut compléter les effets du hasard en confiant à quelques intimes l’adresse de ce site.
On le soupçonnera même – avec plus d’humour que d’ironie – de voir dans le blog un substitut de publication, mais sans les contraintes de la publication, sans l’examen de passage et la hantise du rejet, sans l’obligation de participer au spectacle publicitaire, sans le professionnalisme lourdingue qui transforme l’écrivant en écrivain.
L’écrivant? L’écrivain? Je sais bien qu’il s’agit aussi d’un jeu de mots, assez pauvre, mais j’y attache de l’importance. Oui, je ne me perçois pas (je ne me perçois plus) comme un écrivain mais comme un écrivant et je ne m’en sens pas diminué. Au contraire. Tout écrivain ( d’accord, je ne connais pas tous les écrivains et ma formulation est au moins présomptueuse) est d’abord une auto-entreprise que son PDG salarié rêverait de faire absorber dans un de ces puissants groupes ayant pignon sur rue et se nommant, par exemple, Gallimard, Le Seuil ou ActesSud. Ce n’est pas (ce n’est plus) de mon goût. J’aime écrire, j’ai besoin d’écrire, j’ai besoin d’être lu et j’aime être lu, mais je n’ai pas du tout envie de gloire ou de pouvoir ou d’argent. Je me perçois comme un écrivant.
Je n’ai besoin ni envie de gloire, de pouvoir ou d’argent, mais j’ai besoin de l’autre. L’autre! qui c’est çà, l’autre? Je n’en sais rien. Ou, pas grand chose. Ou trop de choses, si contradictoires qu’elles semblent s’annuler, mais avec un reste. L’autre, c’est l’extériorité radicale qui porte un jugement de valeur sur ce que j’écris, comme s’il savait mieux que moi comparer ce que j’écris avec ce qu’il faudrait que j’écrive. Mais l’autre, c’est en même temps et dans le même lieu, l’intimité absolue : il m’habite, voire, me hante. Sa présence se confond avec la mienne : l’autre est un je qui, à l’instar de n’importe quel je, se prend pour la substance même de tous les je.
Mais, s’il en est ainsi, pourquoi ne pas se contenter d’écrire sur une feuille de papier ce que je crois avoir besoin d’écrire ? S’il en est ainsi, pourquoi ce surcroît de concentration personnelle (et de mauvaise foi!) vers la Toile? Pourquoi un blog, s’il en est ainsi?
Je devrais peut-être me répondre, sur ce point aussi, que je n’en sais rien ! Je n’en sais rien, mais je n’apprécie pas de n’en rien savoir : d’une manière ou d’une autre, j’aimerais bien savoir: j’aimerais tellement au moins deviner que j’en arrive à deviner que l’autre éprouve comme l’urgence de me lire. Comme si l’autre écrivait à ma place et dans le même mouvement se lisait et, se lisant, cherchait à s’approuver : oui, c’est ça, c’est presque ça, ça peut sortir, c’est mûr ou presque… Au fond (ou superficiellement, c’est selon), quand je me trouve dans cette conjoncture, je me ressens disparaissant au profit d’un autre auquel alors je mets la majuscule. Je n’est pas un autre, l’Autre est je.
La majuscule s’impose doublement , elle souligne la différence (en un sens, ce n’est pas moi qui écris, c’est l’Autre) et elle insiste sur le fait (oui, oui, on peut considérer cela comme un fait!) que l’Autre n’est pas, substantiellement, une personne comme vous ou moi, ce n’est pas une divinité anthropomorphe (dieu ou muse), c’est l’être . Prière – même si on a envie de rire ou de s’agacer – de se reporter au lien précédent : il renvoie à tout une série (ouverte) de liens où je tente de m’expliquer. Pourquoi pas ?
 Pas de commentaire »
Pas de commentaire »
 Publié par admin dans ouverture
Publié par admin dans ouverture
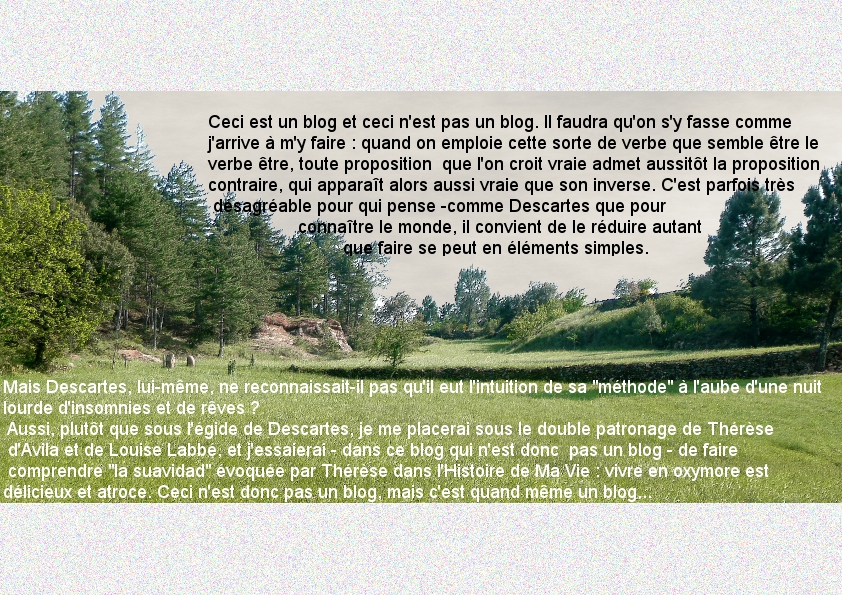
(modifié, le 27 août 2012)
Entre juin 2011 et août 2012, ont été ajoutés (outre des billets qui n’apparaissent pas encore) :
présence
Antigone de la Méditerranée et aujourd’hui même Les Poètes au secours : Colette Gibelin (suite)
(modifié, le 12 juin 2011)Retour sur Chasssiers, après une longue interruption. Cette fois, il est à nouveau question de la transformation de la réserve foncière du Bosquet en éventuel (très éventuel, à ce jour) éco-quartier du Pradel. Pour accéder à ce billet, vous pouvez soit passer par la page Chassiers soit aller directement à l’article sur le quartier du Pradel
(Modifié le 25 mai 2011) Lentement, mais sûrement pas sûrement, ce blog continue à évoluer. Depuis le 18 janvier 2011, y ont été ajoutés :
Les Mystères de Chassiers (1)
Une étude sur Gels de Michel Serres
Un coup de gueule contre le gaz de schiste en Ardèche
Mille Ans plus tard : une nouvelle découpée en 8 billets
et, hier encore:
M.B-L : M point B tiret L
et aussi Une rencontre en terrasse
« Ailleurs-sur-Toile » est-il un blog ?
Réponse d’autant plus difficile que ce concept n’a pas ou n’a plus la transparence des définitions évidentes. Disons qu’en gros, à mes yeux, un blog est en apparence l’équivalent d’un journal intime (autre concept tout aussi peu évident!) qu’on mettrait en ligne, en feignant d’être mû par un accès de sincérité altruiste, mais sans trop parvenir à cacher qu’on aimerait bien qu’il soit ouvert, parcouru et commenté par le plus grand nombre possible de visiteurs. Il s’agirait donc d’une intimité affichée, voire référencée de telle manière qu’à la limite ce soit un site ordinaire, parfois même à visées nettement commerciales.
« Ailleurs-sur-Toile » évite les référencements systématiques et, sur ce point, il est très efficace puisqu’il a réussi à rester hyper-confidentiel alors qu’il existe depuis octobre 2008. Mais il partage avec le blog classique l’aspect faux-jeton d’une bouteille jetée comme à la mer alors que le naufragé n’ignore pas qu’il se trouve sur une plage très fréquentée. À la vérité (si tant est que celle-ci soit dicible, si tant est qu’elle existe), je place dans « Ailleurs-surToile » des textes et des images – et pourquoi pas, un jour, des fichiers audio ou vidéo ? – qui sont destinés à une sorte de publication, destination qui a du mal à s’avouer comme telle. Et pourquoi donc ?
« Ailleurs-sur-Toile » propose le choix entre deux directions qui, chacune à sa manière, récusent la publication au sens habituel. Pour tout ce qui concerne le village et la commune de Chassiers, dans le sud de l’Ardèche, les billets pourraient être reçus, pour certains comme des articles de presse relevant d’une sorte de bulletin municipal, pour d’autres comme les chapitres d’un livre d’histoire qui chercherait un éditeur. Pour les uns et pour les autres, je recule par paresse devant cette interprétation : je n’ai plus l’âge des bulletins municipaux ou anti-municipaux et transformer mes essais en livre d’histoire me fatigue rien que d’y penser!
C’est un peu différent pour les billets regroupés dans « Création ». Il s’agit ici de textes (et d’images) dont la publication me ferait plaisir mais à la condition qu’elle ne m’entraîne pas dans un engrenage d’écrivain. S’il m’est arrivé – dans un passé fort lointain remontant au millénaire précédent – d’être publié par « Pierre-Jean Oswald », « Les Presses Universitaires de France » ou la « N.R.F. », s’il m’arrive encore de me trouver en contact avec des amis estimés qui font partie du microcosme culturel français, je ne tiens pas à m’y ré-incruster, à cause des aspects clinquants de ce monde (qui ne se réduit pas à eux, j’en conviens volontiers) et aussi parce que je ne me vois pas multiplier les démarches qui accompagnent logiquement ce genre de publication. Toujours, la paresse !
Pour ce dernier point, je tourne la difficulté en me refusant à tout droit sur ces billets. Je me contente de souhaits : en premier lieu et surtout, qu’ils ne servent pas à des fins commerciales ; que, s’ils sont recopiés tels quels ou sans transformation importante, l’adresse du blog soit signalée ; que, s’ils entraînent des commentaires, ceux-ci se modèrent d’eux-mêmes. Mais – je le répète – il s’agit de souhaits et non de droits exigibles.
(Mise à jour et au point, commencée le 19 octobre 2013) à suivre….
 Pas de commentaire »
Pas de commentaire »
Ou : de l’inexistence (18)
Voici une expression toute faite. Presque un syntagme figé. Massivement signifiante et renforcée dans sa massivité par l’allusion à l’expression latine qu’elle traduit, comme le rappelaient jadis les pages roses du dictionnaire le plus connu. « Hic et nunc ». Ce n’est pas rien « Hic et Nunc » ! ça souligne qu’on est enfin dans le simple et le sens, qu’on échappe enfin à la perte de vue des perspectives qui s’ouvrent ordinairement sur les temps et les espaces. Enfin dans le clair !
Et pourtant…
Imaginez par exemple que nous nous trouvions parmi une petite foule, disons sur l’esplanade du château de la Vernade à Chassiers et que nous nous disions en nous-mêmes et surtout les uns aux autres que c’est bon de tout oublier et de se sentir « ici & maintenant ». Bien sûr, nous sommes sincères – et il me faudra interroger cette incontestable sincérité qui nous fait nous éprouver si intensément fraternels – mais, continuons à imaginer et rêvons que l’un d’entre nous demande : « Oui, bien sûr, nous sommes bien ici et maintenant, mais où est ici ? et, quand est-ce, maintenant ?
Cette double question, personne d’ordinaire ne se la pose, tant les réponses en semblent évidentes. Ici, c’est l’esplanade du château de la Vernade, à Chassiers, village du sud de l’Ardèche. Et on ira même jusqu’à donner les coordonnées d’ici en latitude, longitude et altitude. Pas de mystère ici ! Quant à maintenant, mon chronomètre m’en précise à la seconde près la date exacte. Bien sûr, elle est vite dépassée, mais il est toujours possible de se mettre à jour. Pas de mystère non plus à cette heure !
Regardons-y pourtant d’un peu plus près. D’abord, je pense que nous serons tous d’accord pour constater qu’en nous fixant sur cet instant, nous adoptons une attitude qui n’est pas conforme à ce que la vie ordinaire semble attendre de nous. Sensibles seulement à l’intensité du présent, nous abandonnons en effet toute projection vers le futur ou vers le passé, même si nous avons des souvenirs que nous croyons avoir vécus à cet endroit, même si nous envisageons d’y revenir ou de le transformer. Et si ces souvenirs ou ces éventualités ne se dissipent pas et parviennent à nous tirer en dehors de la présence de l’instant, nous les ressentons comme nuisibles, nous gâchant le moment. Sensibles seulement, nous n’éprouvons pas le besoin de conceptualiser, de prendre du recul. Nous nous faisons accueil, recueil. Poreux à quelque chose qui nous semble nous enclore, nous découvrons l’usage merveilleux d’un autre sens qui serait comme la quintessence (ou plutôt une « sexessence » !) des cinq sens ordinairement répertoriés.
Dans le même instant, nous voyons, nous entendons, nous touchons, nous humons, nous goûtons, sans qu’il soit possible de distinguer, de hiérarchiser, de classifier. Il ne reste qu’une évidence : l’épiphanie d’une présence.
Bien entendu, ce que j’en dis ici, je le dis. Je recours au langage conceptuel pour me faire comprendre. Je le reconstitue approximativement pour comprendre et me faire comprendre. Je ne le revis pas. Je le reconstruis. Je le fabrique. Et, l’inventant, je le manque et je vous fais le manquer ! Et c’est fort irritant et ce serait décourageant si, au cœur de cette irritation et par son biais, ne se levait la possibilité d’un autre « ici & maintenant », d’une autre irruption de la présence. Alors, je m’obstine …
*

(Il est possible d’avoir sur le plein écran cette image en plus forte résolution : il suffit d’un clic-gauche dessus puis taper la touche F11)
Avant cette parenthèse conceptuelle, j’essayais d’évoquer justement l’épiphanie du présent qui se manifeste « ici & maintenant ». J’y reviens (comme si on pouvait revenir sur tel ou tel « hic et nunc »!). Abandonné à l’instant intense, chacun de nous le sent coïncider avec soi, grandir, s’amplifier et ce faisant nous emplir au point que nous pourrions nous sentir au centre du monde, si justement le monde n’était là, partout et toujours, sans avoir besoin de centre. Il est aussi bien le centre d’un cercle infini dont la circonférence est partout et le centre nulle part que le centre d’un cercle ponctuel dont le centre et la circonférence coïncident…
Car ce que nous ressentons, ce n’est pas l’intensité de la nuit sur cette esplanade où se projètent des images et des sons musicaux, c’est la présence d’une sorte de point de fuite qui serait commun à toutes les perspectives possibles, un point de fuite dont la fuite rassemblerait toutes ces choses que le langage conceptuel sépare pour essayer de mieux les appréhender. En fait, chacun d’entre nous n’est plus alors que ce point de fuite, la fuite de ce point, une fuite qui serait tout aussi bien un rapt : soudain, nous ne sommes plus rien et nous sommes tout. Comme Yves Bonnefoy, je dirai que « l’univers (nous semble ici & maintenant) qu’une seule grande unité, indécomposable, respirante », à la fois abolissant toutes ces choses et tous ces êtres que le langage conceptuel a inventés et leur conférant une force, oui une intensité, que le langage conceptuel est incapable de leur donner. Comme si ces choses et ces êtres (chacun de nous, par exemple), dans le mouvement immobile de la fuite et du rapt, parvenaient à naissance à cet instant même, s’y révélaient dans un éternel état naissant.
Empruntant toujours à Yves Bonnefoy(« Entretiens sur la Poésie », page 295, Mercure de France), je dirai que le peuplier aperçu naissant dans la nuit transfigurée par « ici & maintenant » , joignant à contre-clair ses branches où frémissent des contrastes, me donne accès à une sorte de réalité, expérimentée de façon certaine mais à jamais non-verbalisable. Bien que je veuille éperduement croire qu’elle exige d’être par moi verbalisée.
*
À la différence du poète, je dirais aussi que cette réalité n’est pas composée de cette nuit, de ce peuplier, de ces ombres, de ces sons, de cet écran mais qu’elle m’oblige à me la représenter comme composée de ces choses. Ces choses ne sont peut-être pas des choses, au sens qu’elles seraient, avant que nous les percevions, inscrites réellement dans la réalité avec les formes, les couleurs, les sons, les odeurs, les contacts que nous affectons ordinairement à la réalité de la nuit, du peuplier, des ombres. Je suppose au contraire qu’il n’y a pas d’autre réalité pré-verbale (ou anté-conceptuelle) que la réalité une et indivisible : l’Être. Et je suppose que placé, ici & maintenant, en présence de sa manifestation, j’éprouve un choc instantané à me sentir à la fois annihilé et intégré dans le tout de l’Être. Je n’existe plus. Mais j’inexiste. Inexister, ce serait alors se percevoir contraint par la réalité (par l’Être, dont je rappelle ici qu’il ne peut se réduire à une personne ou à une chose) contraint d’apparaître dans le même et toujours immobile mouvement par lequel, ici & maintenant, la nuit transfigurée m’apparaît. Ici & maintenant, j’accède à l’existence, neuf et définitif, hors du temps et de l’espace. J’emplis « de ma légère existence » (pour reprendre l’expression de Rousseau) la réalité de cette nuit.
Comme ici & maintenant ne s’inscrit pas dans les perspectives du temps et de l’espace, je ne devrais pas pouvoir dire (mais je le dis quand même) qu’après ici & maintenant j’en reviens au langage du concept, du temps, de l’espace et que j’essaie « alors » de raconter mon aventure. Mais je le dis quand même car ces instants qui ignorent la durée et l’étendue exigent des paroles qui n’obéiraient à aucun lexique, à aucune syntaxe, qui exigeraient d’en rester sur « l’envers disloqué des mots » (Yves Bonnefoy), ce qui m’est impossible : alors (oui, alors : dans la durée), je passe à l’endroit loquace des mots pour essayer (en vain? en presque vain?) de raconter mon aventure.
Il y a tant de silence et tant de plein ici & maintenant, tant d’immobilité aussi que la prose ne peut qu’y faire allusion. L’allusion suffit-elle ? En un sens, oui : les significations que ses mots entraînent peuvent en effet entraîner à leur tour le prosateur et ses lecteurs (espérons-le !) dans une disposition d’âme (sur le mode de la pensée) et de corps (sur le mode de l’étendue) qui les met en mesure d’ accueillir ici & maintenant. Alors, ils s’apprêteront à vivre, en intensité – et non plus dans l’espace et le temps – la manifestation de la présence. Et si rien d’extérieur (rien qui vienne de l’espace ou du temps) ne vient perturber cet accueil, ce recueillement, alors ils aurant peut-être le sentiment exaltant de leur inexistence. L’endroit loquace des mots n’est donc pas (n’est donc peut-être pas) condamné à manquer ici & maintenant, mais il peut tout au plus espérer établir un contexte favorable. En aucun cas, il ne peut prétendre écrire ici & maintenant.
Reste qu’inexistants ou existants, nous nous représentons à nous-mêmes comme étant définitivement liés à la parole et que le simple fait de vouloir persévérer dans notre être (dans ce que nous croyons notre être) nous contraint, ici & maintenant, à passer de l’envers disloqué à l’endroit loquace des mots. Mais ce passage trahit obligatoirement ici & maintenant, puisque cet instant exclut tout déroulement temporel. Alors, on bricole : soit on n’insiste pas et on oublie l’instant magique (c’est sans doute le cas le plus fréquent : on se souvient qu’il fut, donc on croit ne pas l’oublier, mais on l’oublie), soit -comme je l’ai fait précédemment – on l’évoque conceptuellement/prosaïquement et on se contente de l’allusion (cas très fréquent aussi), soit on s’acharne à transcrire l’envers disloqué des mots et à inventer un langage fait de mots neufs que certains cherchent du côté des arts et d’autres du côté de la poésie.
*
Je voudrais insister sur ces deux derniers choix.

C’est la reproduction (par scanner interposé) de la reproduction (par couverture imprimée interposée) d’une œuvre de Françoise Rohmer placée en couverture du recueil de poèmes « Eclats et Brèches », de Colette Gibelin. Là aussi, faire clic gauche + touche F11.
Je me représente le flash d’ici & maintenant comme une sorte d’explosion immobile : une pierre tombe à la surface de la mare et s’enfonce dans les profondeurs sans faire de ronds dans l’eau… Mais l’immobilité de l’eau là où la chute a lieu, je ne la ressens pas comme une absence de mouvement. Au contraire, ce serait plutôt le saisissement de la pierre s’apercevant qu’elle est eau ou tout aussi bien le saisissement de l’eau s’apercevant qu’elle est pierre : la réorganisation soudaine du monde par une infinité de réajustements immédiats sidère la conscience que j’essaie d’en prendre et cela chahute tellement et cela va tellement vite que c’est l’image même de l’immobilité, du silence. Comment transmettre cette aventure ?
Plutôt que d’en passer par nos mots – dont nous sentons bien qu’ils sont par nature incapables de recréer l’instant – il peut être tentant de recourir à des signes sensibles que leur caractère sensible apparente aux choses du monde. Ces signes sensibles nous semblent alors s’ajouter au monde et, s’y ajoutant, en bousculer l’ordre établi ou du moins la représentation établie que nous nous en faisons et, le bousculant, nous le faire apparaître sous un jour neuf, oui, à l’état naissant. Et cet accès à l’état naissant, nous faisons le pari qu’il est l’homologue de la traversée instantanée de la conscience par ici & maintenant. Sons musicaux, traces du pinceau sur une toile, taches et formes sur l’écran, proférations sur la scène de théâtre ou d’opéra, édifices et statues nous apparaissent comme des choses réelles puisqu’elles sont accessibles à la sensibilité qu’elles contribuent à remodeler de manière homologue à la traversée instantanée de la conscience par ici & maintenant. En ce sens, une œuvre d’art est réussie – quelle que soit par ailleurs la valeur qui lui est attribuée par l’histoire de l’art ou le marché – quand elle déclenche chez celle ou celui qui la perçoit un remue-ménage intime (pas forcément agité, on le devine, je pense) lié à cet incroyable accroissement d’être.
La ballade du saxo d’Archie Shepp parmi la nuit algérienne et ses crécelles. L’épaisseur qui s’amenuise et disparaît d’un coup de pinceau dans la couleur sur quelque tableau que ce soit. Le rond de fumée qui s’exhale du dernier soupir et le regard étonné d’une femme qui ne le regarde même pas. L’installation d’une voix de basse peu connue dans le volume des croisées d’ogives de l’église de Chassiers. L’accord parfait d’une petite statue de vierge à l’enfant, en bois, à la catalane et dans la pénombre d’une chapelle romane… Autant de choses réelles. Autant d’artefacts. Autant d’intensité. Autant de virtualité.
Je renvoie à ce texte destiné à une amie peintre qui présentait une exposition de son travail à Chassiers, en 2008.
Mais il peut arriver que des contingences personnelles orientent celle ou celui qui veut transmettre l’aventure d’ici & maintenant à s’acharner sur le langage pour tenter d’opérer enfin ce passage impossible de l’envers disloqué des mots à leur endroit loquace. Comment parvenir à conserver la fraîcheur native du pré-verbal (fraîcheur souvent éruptive, bouillonnante, explosive…) tout en l’écrivant ? Il n’y a pas de recettes, bien sûr, mais accepter cette contrainte c’est s’engager dans des formes qui bousculent les règles syntaxiques et lexicales de la prose dans la mesure où ces règles tendent toutes à réduire le mot au concept, à en privilégier la signification sur le matériau. Or ici, pour le poète, le matériau verbal compte plus que les significations, même si le duel de celles-ci avec celui-là peut contribuer à l’avènement du poème. Avec le poème, les mots essaient de conserver cette matérialité que la prose leur demande de dépouiller : ils s’essaient à se conduire en choses. En choses dotées de ce que nous attendons d’une chose : son épaisseur (sa troisième dimension), son rugueux, son contact, ce que nous appelons « sa réalité ».
Et nous comprenons bien (conceptuellement !) qu’il y a là une nécessité : placés au contact de l’Être par ici & maintenant, nous avons ressenti ce que l’Être est, son épaisseur, son rugueux, son implacable opacité, donnés et repris d’un seul coup, et nous essayons dans le poème (écrit ou lu) de maintenir actifs et naissants ces caractères. Alors, le recueil de poèmes ne se présente pas comme un roman, le papier y joue son rôle et la police de caractères et le corps et toutes les indications graphiques (le vers, la strophe, la césure, le rejet… l’imagination des poètes semble sans limites) et le bruit des phonèmes et de leurs agencements (leur musique, mais pas seulement, leur texture aussi, voire leurs fragrances à parfums d’asphodèles – « les souffles de la nuit flottaient sur Galgala ».
J’ai essayé dans plusieurs billets antérieurs
(aller à De l’inexistence et aller sur les renvois à Yves Bonnefoy, Bernard Noël et Colette Gibelin)
de souligner cette dé grammaticalisation des mots que le poème tente et ce n’est pas (seulement) par jeu. En fait, appliquée à un poème entier, surtout quand il est assez long, la tentative se révèle décevante car le commentaire qui l’accompagne se déroule nécessairement dans le champ des concepts et paraît bien bavard par rapport à ici & maintenant.
Quelle que soit la précision du commentaire, l’impression de bavardage demeurera. Mais il est important et souhaitable qu’elle demeure ! Je suis convaincu, en effet, qu’elle nous permet à la fois d’appréhender l’irréalité de la pensée conceptuelle et du monde auquel elle est adéquate (notre monde, celui dans lequel nous croyons exister, le seul où nous puissions vivre durablement) et de « réaliser » ce qu’ici & maintenant nous apporte dans les instants de présence. Nous ne pourrons pas suivre le passage de l’envers disloqué à l’endroit loquace, puisque ce passage n’est pas de notre monde (et puisqu’il n’est donc pas un passage !), mais la désillusion du bavardage – aussi déprimante soit-elle souvent – peut nous suggérer un nouvel accès à ici & maintenant. Je pense en particulier à cette confidence de Bernard Noël : «Cet infranchissable pourrait être l’autre nom de la mort. Un nom qui dirait, pas la mort, mais l’intrusion subite du mourir, verbe actif mais d’une activité réduite et foudroyante», laissant bien sûr à ce poète le choix de ses mots mais leur substituant des synonymes : cet infranchissable pourrait être l’autre nom de la naissance. Un nom qui dirait, pas la naissance, mais l’intrusion subite du naître, verbe actif mais d’une activité réduite au foudroiement.
*
pour Amandine et Jean-Pierre Menuge
comme en remerciement
dix-sept ans
comme on est sérieux quand on a dix-sept ans
dans le giron des jupes le violoncelle
repose le silence espère
dehors la nuit ce soir dans le couchant
n’en finit pas de lever son bras nu
la main à l’archet suspend son geste
on retient son respir
l’espère du moment aspire à l’être
quelque chose se déporte s’ouvre et fuit
le violoncelle et le clavier s’accordent un soupir
déjà le monde n’est plus
le monde
l’être est et c’est tout
on n’est déjà plus qu’un
à peine un peu plus que rien
on emplit de ce rien le monde qui n’est plus le monde
on s’en va on s’en vient on ne sait
plus
ou à peine
La nuit ce soir dans le couchant n’en finit pas de lever
le ciel
son or évanoui le ciel
est lisse et tendu pour l’accord
l’espère et le respir suspendus au geste de la nuit
elle advient de si loin
d’un si profond nulle part
de partout
au plus bas de la plus basse des cordes une main
s’apprête
quelque chose se déporte s’ouvre et fuit.
*
Les visiteurs intéressés par ce billet le seront peut-être aussi par celui-ci mais aussi éventuellement par celui-là
 2 commentaires »
2 commentaires »
Qui pourrait aussi s’intituler, bien entendu : De l’inexistence (8)
Voir le précédent billet de cet aiguillage ICI
Une fois n’est pas coutume : je vais réagir à un article de lemonde.fr, lu récemment (mercredi 3 décembre 2008) et intitulé « Galilée et les Indiens ». Le titre exact est » Galilée et les Indiens » d’Etienne Klein : pour que la science ne soit pas un récit parmi d’autres ». Il est court et je le cite en entier :
Alors que les pays occidentaux sont encore loin d’avoir pris la mesure des conséquences de la désaffection croissante pour les disciplines scientifiques, voici un ouvrage essentiel. Décrivant les menaces du relativisme, Etienne Klein, spécialiste des sciences de la matière et docteur en philosophie des sciences, use dans Galilée et les Indiens de tous ses talents de vulgarisateur pour défendre la connaissance pour elle-même et la science, ce « trésor d’incomplétude ».
Une anecdote résume les dangers qui nous guettent. « Au terme d’un cours donné devant 200 étudiants, alors que je venais de terminer au tableau un calcul de relativité restreinte montrant que la durée d’un phénomène n’est pas la même pour tous les observateurs (ce qu’on appelle la « dilatation des durées »), un jeune homme demanda la parole : « Monsieur, personnellement, je ne suis pas d’accord avec Einstein ! » J’imaginai qu’il allait (…) argumenter, écrit Etienne Klein. Je l’invitai donc à s’expliquer : « Je crois pas à la dilatation des durées que vous venez de calculer, se contenta-t-il de répondre, parce que je ne la… sens pas ! »"
Ainsi en ce début du XXIe siècle, un jeune homme peut-il, fort de ses intuitions et de sa subjectivité, contester devant son professeur un résultat que près d’un siècle d’expérimentation et d’objectivation a permis de valider. Pour Etienne Klein, il faut voir là un symptôme éclairant de ce mal de moins en moins rampant que sont les thèses « relativistes » qui, nous dit-il, alimentent des critiques de plus en plus vives de la démarche scientifique.
Avec ce relativisme, la pratique de l’astrologie, celle du vaudou seraient des voies de connaissance comparables à la physique nucléaire ou à la biologie moléculaire. La Science devrait au plus vite se débarrasser de sa majuscule, et ceux qui la servent auraient intérêt à reconnaître qu’ils ne font qu’écrire un récit parmi tant d’autres. De quel droit la raison raisonnante devrait-elle l’emporter sur des appréciations esthétiques ? L’auteur brosse un portrait sans concession de notre époque où l’engouement se substitue au raisonnement, où la conviction intime, le goût spontané comptent plus qu’une argumentation solide ou une critique rigoureuse.
« Avec Galilée, la science est devenue efficace, mais son efficacité semble aujourd’hui se retourner contre elle, observe Etienne Klein. Ce ne sont plus l’arbre et les fruits qui nous intéressent, mais les compotes, confitures, liqueurs et autres jus que nous pouvons en tirer. » Or la source sera bientôt tarie si l’on ne cultive pas un esprit scientifique fondé sur les spéculations désintéressées et la connaissance pour elle-même. »
Je n’ai pas lu le livre auquel il est fait référence et l’article lui-même est beaucoup plus promotionnel que philosophique. Mais il fait toucher du doigt une série de questions qui concernent ce qu’on appelle souvent « la science galiléenne ». Comme ces questions ne sont pas sans rapports avec l’inexistence, j’ai envie d’insister.
Et de dire que nous sommes imprégnés d’un récit sur la Science qui suppose celle-ci « fondé(e) sur des spéculations désintéressées et la connaissance pour elle-même ». Ce récit, souvent présenté lui-même, quel que soit le récitant, comme historique, c’est-à-dire (mais implicitement) comme scientifiquement démontré, fait commencer à Galilée une aventure, continuée par bien d’autres savants, notamment par Newton et par Einstein. À partir du « Dialogue pour deux sciences nouvelles… »(publié à la fin de sa vie), Galilée aurait ainsi inauguré la rupture nécessaire entre la Physique et la Métaphysique, jusque là confondues dans la « philosophia naturae ». Cette rupture ayant eu lieu, la science désormais se serait débarrassée du fatras qui l’encombrait depuis Aristote et consorts et aurait ainsi pu élaborer une description du monde de mieux en mieux adéquate au monde, parfois dénommé « la nature » ou encore « la réalité » ou encore « l’être ».
Ce récit charpente la représentation que beaucoup d’Occidentaux et d’Occidentalisés considèrent comme la seule réelle par rapport aux illusions et babioles des religions, de la poésie, de l’astrologie et du vaudou (allègrement mises dans le même sac). Je note qu’il a donné naissance (mais par antithèse) à un autre récit qui dénonce, lui, « le désenchantement du monde » dont la science galiléenne se rendrait coupable. Selon ce contre-récit, la science-galiléenne substituerait à la réalité une représentation abstraite, désincarnée et pour tout dire déshumanisée. Oublieuse des Indiens.
Le dialogue entre ces deux types de récits est permanent, mais c’est un dialogue de sourds car aucun des deux (et pas même le contre-récit critique) ne prend en compte les présupposés métaphysiques qui ont conduit le récit principal à souligner la rupture entre Physique galiléenne et Métaphysique. Or ces présupposés métaphysiques plombent l’histoire de la Science.
De quoi s’agit-il ? Supposons que Galilée, en avance sur son temps, comme on dit, mais quand même de son temps, ait partagé avec son époque (celle de la Contre-Réforme triomphante) la conviction que l’Être (ou le Tout, ou l’Un) est le résultat de la Création. Supposons de surcroit (comme tant de documents nous y invitent) qu’il ait imaginé, pour ajuster son oeuvre aux exigences de la théologie contemporaine, que la Création est accessible à l’Homme par deux canaux également suaves au regard du Créateur : les Saintes Ecritures et ce qu’il appelait « la langue de l’Univers ». L’une comme l’autre révélée à l’Homme par le Créateur.
La langue de l’Univers, Galilée la définissait de la façon suivante :
« « La philosophie est écrite dans ce livre gigantesque qui est continuellement ouvert à nos yeux (je parle de l’Univers), mais on ne peut le comprendre si d’abord on n’apprend pas à en comprendre la langue et à en connaître les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit en langage mathématique, et les caractères en sont des triangles, des cercles, et d’autres figures géométriques, sans lesquelles il est impossible d’y comprendre un mot. Dépourvu de ces moyens, on erre vainement dans un labyrinthe obscur. »
— Il saggiatore, en français L’Essayeur.
Autrement dit : le savant qui arrive à comprendre la langue mathématique de l’Univers (à partir de Newton, elle sera autant algèbre que géométrie) accède par la même à l’être de la Création. Certes, cette langue est infiniment complexe et elle échappera toujours par un biais ou par un autre à la Science mais celle-ci est, en dehors de la théologie, le seul moyen d’accès à la Création. Autrement dit encore : la Science n’est pas seulement un récit qui nous aiderait à nous représenter l’Être (un récit parmi d’autres), c’est l’Être lui-même tel que nous pouvons nous le représenter.
Par la suite, le récit (ou l’Histoire de la Science) souligne que beaucoup de successeurs de Galilée s’affranchiront encore mieux que lui des Saintes Ecritures et qu’ainsi, grâce à la seule Science, nous arrivons progressivement à nous rendre, selon la formule de Descartes, « comme maîtres et possesseurs » de la Nature. Ce qui présuppose que la conscience du scientifique ou de son lecteur est une drôle de chose, à la fois intérieure à la Nature dont elle est partie intégrée et capable de prendre du recul par rapport à celle-ci pour l’examiner et la transformer et y retourner, selon des procédures qui sont à la fois naturelles et extérieures à la nature. À aucun moment, il n’est envisagé (sauf sur le mode de l’indignation scandalisée) que la Nature (ou la Réalité, ou le Monde) soit un artfact complexe, virtuel par essence. Comme le sont effectivement les religions, la poésie, l’astrologie, le vaudou…
Ce relativisme peut effaroucher surtout quand on le voit utilisé avec mollesse pour justifier n’importe quoi et notamment une certaine paresse d’esprit qui cherche un prétexte pour échapper aux exigences de la Science. Ce n’est pas parce que la Science serait seulement un récit parmi d’autres qu’elle devrait être abandonnée : au contraire, ce qu’on désigne par « rigueur scientifique » semble bien lié à la nécessité pour la Science – pour la Science en tant que récit – de toujours plus resserrer son homogénéité, d’approfondir ses liens internes, de se retourner sur elle-même, de s’autocritiquer et peut-être de s’apercevoir de mieux en mieux qu’elle n’est qu’un récit, mais un récit exigeant. Quant à l’Être ou à l’Un ou au Tout ou à la Substance, c’est une autre histoire, évoquée dans les premiers billets de cette série
La suite se trouve ici
 Pas de commentaire »
Pas de commentaire »
|

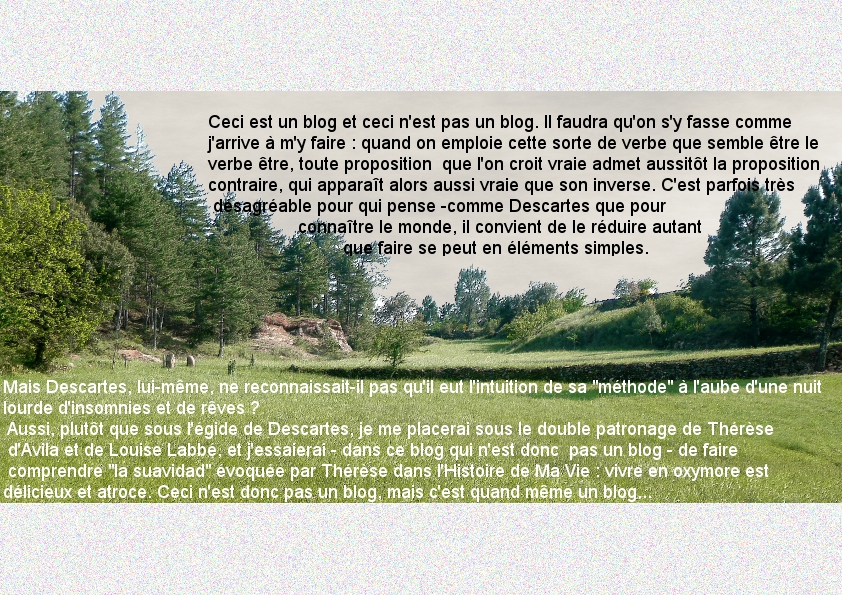


 Bulletins (RSS)
Bulletins (RSS)